
Ce cahier est disponible. Si vous souhaitez le commander, reportez-vous ci-dessous.
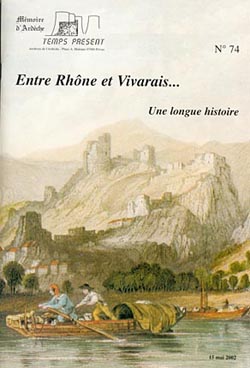
Le Rhône à Rochemaure |
Le Rivage représente, en Ardèche, la rive droite du Rhône avec la plaine alluviale du fleuve et les premiers coteaux et collines qui la limitent vers l’Ouest. Célèbre tout au long de l’histoire des peuples tant pour son rôle d’axe majeur de circulation que pour celui de limite entre Empire et Royaume, voire départements, la vallée du Rhône offre aussi, au plan géologique, une histoire peu commune. La vallée du Rhône que nous connaissons aujourdhui est le résultat d’une longue évolution caractérisée par la succession de nombreux évènements dont la chronologie n’est pas toujours aisée à mettre en évidence. Aussi raconter l’histoire de la vallée du Rhône en quelques paragraphes n’est pas évident. Nous avons quand même tenté d’en présenter les traits principaux tout en attirant l’attention, dès le départ, sur le fait que pour les affluents ardéchois cette histoire est loin d’être claire.
Georges Naud
Le patrimoine culturel, que ce soit celui d’un fleuve, d’une montagne ou d’une ville, peut être défini à une échelle spatiale donnée comme l’ensemble des sites, artefacts, pratiques socio-culturelles et documents iconographiques, qu’une société hérite de son passé et qu’elle entend préserver et transmettre aux générations futures. Reste à savoir ce que nous entendons préserver et transmettre, s’agissant d’une section du Rhône moyen comprise d’amont en aval entre Arcoules - Le Péage-de-Roussillon et le confluent de l’Ardèche. Une double interrogation s’impose au préalable : que faut-il prendre en compte, de façon générale, dans un patrimoine fluvial ? Et quelle est la spécificité du Rhône dans son cours moyen ou ardéchois ?
Jacques Bethemont
Dans un précédent article, (Cahier MATP n° 66, 2000) nous avons remarqué que l’Ardèche de la cité des Helviens était parcourue par un réseau de voies romaines qui se liaient à la voie riveraine du Rhône. Nous avons alors admis, comme un postulat, que la cité accordait grande importance à cet accès au Rhône, voie de communication primordiale. C’est sur elle que nous voudrions donner ici des informations, en particulier quand elle longe l’Ardèche, mais sans, bien sûr, que nous puissions lui consacrer un exposé exhaustif. De même, dans l’abondante bibliographie qui concerne le Rhône dans l’Antiquité, même expurgée de ce qui ne concerne pas strictement les voies de communication d’époque romaine, nous sommes contraints à un choix rigoureux. En revanche, la citation de quelques textes antiques rendront ces quelques notes plus concrètes.
Que disent les cartes d’un fleuve ? Alors que les montagnes à quelques glissements de versants près sont des constructions stables à l’échelle de l’histoire humaine et que la topographie des plaines a quelque chose d’immuable, le tracé d’un fleuve varie, soit en fonction de changements du milieu naturel, variations climatiques qui grossissent ou raréfient ses eaux ou crues exceptionnelles qui peuvent modifier son cours, soit en fonction d’actions humaines qui vont de la rectification du chenal à l’endiguement et à la dérivation en passant par le barrage. La superposition des cartes permet de suivre ces changements et d’en rechercher, tout au moins pour les trois derniers siècles, la dynamique et la logique. Le Rhône se prête assez bien à cet exercice, encore que le corpus cartographique rhodanien soit infiniment moins riche que ceux du Rhin ou du Pô. Du moins un jeu de cartes centré sur un secteur précis, en l’occurrence les PK 120 à 130 ou si l’on préfère Beauchastel - La Voulte, compris entre les confluents de l’Eyrieux et de la Drôme, permet-il de suivre, plus qu’une évolution, un long processus dont les logiques varient d’une époque à l’autre mais qui vont toutes dans le même sens pour aboutir à un double processus d’anthropisation et d’artificialisation qui peut être suivi à partir de l’évolution et de la disparition des îles.
Jacques Bethemont
La construction du pont de Saint-Esprit
de 1265 à 1309 est un des faits majeurs de la période
médiévale. L’œuvre paraissait si colossale
que seule l’intervention divine put la rendre possible.
C’est du moins ce que prétendit la légende
: le Saint-Esprit serait venu à la rescousse des bâtisseurs.
Le pont construit légèrement en amont de Saint-Saturnin
du Port (aujourd’hui Pont-Saint-Esprit) fut donc placé
sous la protection du Saint-Esprit. Un oratoire, puis bientôt
un hôpital et une chapelle furent élevés à
son entrée occidentale alors que le roi de France installait
sa puissance sur la rive droite du fleuve. L’œuvre
chargée de gérer l’entretien de l’ouvrage
sut exploiter le succès de la légende pour attirer
pèlerins et généreux donateurs.
Point stratégique majeur dans la moyenne vallée
du Rhône, important nœud commercial, le pont fut l’objet
de soins particuliers pour sa conservation. Celle-ci était
confiée à une fraternité laïque dirigée
par trois recteurs. On eut d’abord recours au produit des
quêtes, des dons et des legs, puis à partir des années
1382-1390 à la perception d’une taxe sur le sel,
le “petit blanc” du nom de la pièce qui servait
à la régler.
Jean-Louis Issartel
Voie de pénétration, route d’évangélisation,
passage naturel des invasions, le Rhône et sa vallée
sont aussi depuis l’Antiquité un bassin de vie et
d’activités économiques important. Au XVIIIe
siècle, dans ce siècle des Lumières qui ouvre
des perspectives nouvelles aux idées comme aux échanges
commerciaux, le Rhône-fleuve, ses rives, ses îles
et autres lônes sont le théâtre d’un
va et vient d’hommes et de marchandises comme jamais peut-être
on n’en vit.
Les archives qui nous sont parvenues sont suffisamment abondantes
pour nous permettre un regard sur la nature et la densité
de ces échanges, sur leur organisation également.
C’est ce regard qui ne prétend pas à l’analyse
exhaustive que nous nous proposons de porter sur le paysage d’alors
avec la prudence qui sied à toute investigation socio-économique
et à l’exploitation des documents accessibles.
Pierre Ladet
Si la voie de circulation privilégiée, trop peut-être, dans la vallée du Rhône est aujourd’hui l’autoroute rive gauche, il n’en fut pas toujours ainsi et l’ancêtre de notre RN 86 qui en épouse encore l’essentiel du profil, fut souvent l’objet des soins attentifs du pouvoir, particulièrement des États du Languedoc et des États particuliers du Vivarais. Ce fut particulièrement le cas dans la deuxième moitié du siècle des Lumières alors que, on l’a vu, le pouvoir royal se soucie dans le même temps de réduire les effets des péages sur le commerce, cherche en tout cas à en contrôler les effets sinon les bénéfices.
En mai et juin 1766, les États particuliers du “Pays de Vivarais” se tiennent en la bastide royale de Villeneuve-de-Berg. Le Registre des délibérations de l’assiette nous livre les préoccupations des États quant à l’éntretien voire au renforcement de la route qui court le long de la rive droite, ce qu’ils entendent y consacrer en moyens financiers et leurs démarches auprès de l’archevêque de Narbonne, président des États du Languedoc pour que l’intérêt d’une telle route soit très concrètement reconnue.
La Réforme s’est répandue en
Vivarais dès 1528. Les « idées nouvelles »
furent combattues très vite par les autorités ecclésiastiques,
notamment par l’évêque de Viviers, et des
condamnations
à mort prononcées. Pendant de longues périodes,
les protestants du Vivarais comme ceux de la France entière,
malgré quelques tentatives d’apaisement, ont été,
à des degrés divers, considérés comme
des proscrits. Arrêtés, ils risquaient la prison,
les galères ou la mort.
Ainsi, pour les révoltés qui s’opposaient
aux armées du roi ou les pacifiques qui choisissaient l’exil
pour éviter d’abjurer, tout déplacement représentait
un danger. Si les vallées constituaient des voies de communication
utiles, la traversée clandestine des fleuves et rivières
n’était pas sans risques. Le Rhône à
cet égard fut pour les révoltés comme pour
les candidats à l’exil, soit un obstacle à
franchir soit une voie de pénétration ou de fuite.
Notre but est d’illustrer ceci par quelques épisodes
représentatifs, choisis à différentes périodes,
de relative paix sociale ou de répression.
Pierre et Monique Coulet
Le mot « île » évoque
mystère, secret, mais aussi liberté, indépendance.
Les îles des fleuves ont aussi été marquées
de cette aura.
Un numéro précédent de ces Cahiers mentionnait
les réunions de sociétés secrètes
tenues dans les îles du Rhône fort propices à
des activités de ce genre qui requièrent une certaine
discrétion.
Le fleuve formant une multitude d’îles et d’îlots,
séparés par des bras tour à tour peu profonds,
ou, au contraire, en eau rapide, a été le théâtre
de multiples péripéties depuis la victoire de Fabius
Maximus.
Témoin du passage des navires vikings, il vit prospérer
sur son cours d’autres pirates appliquant une taxation sur
les voyageurs et les marchandises. Louis IX, roi de France, sur
le chemin des croisades, fit la rencontre, à Glun, d’un
seigneur qui prétendait faire payer un droit de passage
à son armée. Les péages devinrent par la
suite une institution.
Jean Bouvier
Si le Rhône est conquis, il n’en demeure pas moins sujet à ces colères de la nature qui montrent que l’homme n’est jamais tout à fait le maître. Il en est ainsi des inondations qui ont ponctué les siècles et montré encore récemment, en 1993 et 1994, la force des eaux.
Paul Giraud (1808-1888) est issu par sa mère de la dynastie des industriels albenassiens de Pont d’Aubenas, les Goudard, les Ruelle, et apparenté aux Verny. Il a épousé en 1865 Betsy Théoule, de Chomérac, et vit à Bourg-Saint-Andéol. Il nous a laissé ses souvenirs écrits à partir de notes prises tout au long de sa vie, document précieux sur la vie d’une famille bourgeoise du XIXe siècle. De ce texte, nous extrayons ici quelques lignes écrites en souvenir de voyages entrepris par Paul Giraud le long du Rhône et au-delà, en direction de Paris, ou d’hivers rigoureux et d’inondations dévastatrices.