
Ce cahier est disponible. Si vous souhaitez le commander, reportez-vous ci-dessous.
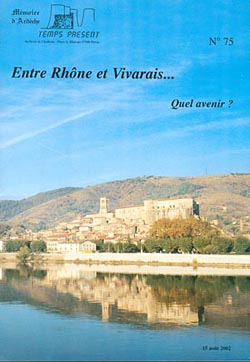 La Voulte-sur-Rhône |
Les frères Seguin sont bien connus pour leurs ponts suspendus
par câbles de fil de fer et par la création du chemin
de fer de Lyon à Saint-Étienne, à l’aube
de la Révolution industrielle en France. Le pont de Tournon
- Tain, sur le Rhône, précède immédiatement
leur tentative de navigation, l’entreprise ferroviaire la
suit de près et pour une bonne part la chevauche. Il y
a bien entendu des relations entre ces différentes activités,
même si leur rapprochement dans le temps et les différentes
technologies en jeu ont de quoi étonner le lecteur d’aujourd’hui.
Le très prometteur pont de Tournon n’est
pas encore inauguré, à la mi-août 1825, que
la Compagnie de navigation par le halage à la vapeur a
déjà ses statuts et l'essentiel de ses actionnaires.
À peine trois ans plus tard, au printemps 1828, puis une
seconde fois au début de l’été, les
frères effectuent la remontée du Rhône au
moyen de leur bateau Remorqueur qui, à chaque fois, tire
derrière lui trois bateaux chargés d’Arles
jusqu’à Lyon.
La performance n’est pas mince, puisque c’est
la première fois qu’une telle navigation par la force
motrice de la vapeur est entreprise sur le fleuve, l’un
des plus difficiles d’Europe occidentale. Et pourtant elle
passe inaperçue, y compris des historiens rhodaniens les
plus scrupuleux qui se réfèrent généralement
au voyage inaugural d’Edward Church, un ingénieur
et un armateur installé depuis quelques années à
Lyon et Genève. Le Pionnier de l’Américain
triomphe du fleuve un an plus tard, tout aussi laborieusement
que les Seguin d’ailleurs. Une telle ignorance est due pour
une bonne part à l’attitude des frères eux-mêmes.
Ils viennent en effet de décider la liquidation de l’entreprise
jugée beaucoup moins prometteuse que le chemin de fer auquel
ils choisissent de consacrer tous leurs efforts… Du coup
la performance des bateaux est passée sous silence !
Comment en est-on arrivé là ?
Quels sont l’actif et le passif d’une telle aventure
rhodanienne, souvent perçue comme un échec des frères ?
Michel COTTE
Dans le premier quart du XIXe siècle, le commerce et l’industrie du nord de l’Ardèche souffrent de la difficulté des relations entre les deux rives du Rhône : ponts de pierre et bacs sont rares. Ce sujet est évoqué dans les années 1820 au cours d’un dîner chez le docteur Duret d’Annonay auquel assistent, entre autres, Bruno de Plagniol, ingénieur des Ponts et Chaussées, et Marc Seguin. Selon la tradition, monsieur de Plagniol aurait dit à Seguin : « Vous qui avez le génie de l’invention, vous devriez chercher un moyen de remplacer les ponts en pierre par un autre système aussi solide et moins coûteux ». En fait, Seguin a lu un article du Moniteur du 8 décembre 1821 faisant une recension du livre de J. Cordier Histoire de la navigation intérieure dans lequel l’auteur évoque de nombreux ponts suspendus en Amérique, notamment à chaînes, parfois en fil de fer.
Marie-Hélène REYNAUD
L’Ardèche a connu deux périodes sidérurgiques majeures. La première au cours de la Protohistoire avec les Ages du fer entre 700 et 50 a.v. J.C. et la seconde au moment de la “Révolution industrielle” au XIXe siècle. C’est de cette dernière dont il est question dans cette note.
De Gensanne, de l’Académie de Montpellier, réalise une étude sur l’histoire naturelle de la province du Languedoc qu’il publie en 1776. Il signale notamment à La Voulte, “d’excellentes mines de fer qui consistent en gros filons de mine hématite ; il est fâcheux que le défaut de bois n’en permette pas l’exploitation”. Ce n’est donc pas un hasard si les premières velléités sidérurgiques apparaissent à La Voulte dès 1797. Toutefois, la production sidérurgique ardéchoise ne verra vraiment le jour qu’avec la construction et la mise à feu, en 1828, des premiers hauts fourneaux voultains. Sur la rive ardéchoise du Rhône elle ne prendra de l’ampleur qu’à partir de la mise en exploitation des mines du bassin de Privas, en 1843. Elle occupera trois sites, Le Pouzin, La Voulte et Soyons, sur des périodes plus ou moins longues, pilotée en grande partie par industriels et banquiers des régions stéphanoise, lyonnaise voire parisienne.
Georges NAUD
En mars 1937, la revue Technica édite un numéro spécial sur Les grands travaux dans la région lyonnaise et la vallée du Rhône. Ce numéro centré sur la capitale régionale accueille cependant dans ses colonnes l’article de M. G. Thévenin, diplômé de l’École Centrale de Lyon, promotion 1905, sur les travaux à entreprendre dans le but d’une amélioration des conditions de navigation sur le fleuve. Une analyse et un point de vue qui participent aujourd’hui à l’histoire du Rhône et que nous reproduisons ici in extenso accompagnés des illustrations originales.
Il est difficile de limiter un aperçu
sur la Compagnie Nationale du Rhône (C.N.R.), même
succinct, au département de l’Ardèche. mais
il est impossible de passer sous silence le rôle, même
modeste, qu’a eu la C.N.R. sur le développement de
la rive droite du fleuve.
La navigation sur le Rhône existe depuis la plus haute Antiquité.
Elle y était néanmoins difficile, contrariée
par la forte pente et l’importance du courant : l’aménagement
du fleuve était indispensable pour que ce moyen de transport
prenne une réelle importance économique. En 1899,
au cours d’une réunion à la chambre de commerce
de Lyon, les délégués régionaux constatent
que la batellerie souffre beaucoup de la concurrence du chemin
de fer. Parallèlement, les chambres d’agriculture
encouragent de plus en plus l’utilisation de l’eau
du fleuve pour l’irrigation. Enfin, en ces années
du début du XXe siècle, la production d’électricité
par la houille blanche est passée du stade expérimental
des petites installations à des projets beaucoup plus importants.
Ces trois facteurs se conjuguent pour inciter à un aménagement
du Rhône, mais se concurrencent pour l’utilisation
de capitaux car, dès ses premiers balbutiements, ce projet
se révèle devoir être une opération
très coûteuse en capitaux à investir dans
une période de dépression, En effet, si les réalisations
énergétiques et d’irrigation pouvaient se
faire isolément et localement, l’aménagement
de la navigation devait couvrir l’ensemble de Lyon jusqu’à
la Méditerranée pour être efficace.
Michel APPOURCHAUX
Consacrer un Cahier au fleuve roi ne peut s’envisager
sans évoquer les ouvrages d’art qui permettent son
franchissement. Les divers bacs à traille qui ont permis
aux Ardéchois d’aller en “Dauphinois”
ont tous disparu, ils ont laissé çà et là
des noms de lieux, de chemins ou de rues.
Le pont Frédéric Mistral actuel , malgré
ses quatre voies, ne peut à lui seul résorber un
trafic de plus en plus important. Le nouveau pont, en projet depuis
vingt ans, est entré en phase de réalisation au
sud de la ville en novembre 2001.
Jean-Yves BOIS
Depuis son glacier d’origine jusqu’à la Méditerranée, le Rhône traverse des régions fort différentes. On peut néanmoins distinguer sur son cours français trois grandes zones : du Léman à l’embouchure de la Saône, du sud de Lyon jusqu’aux approches du delta, qui se développe peu après Avignon, et enfin le grand delta, qui irrigue, au-delà même des Bouches-du-Rhône, toute la région qui va de Marseille à Montpellier. Le haut Rhône a reçu (ou subi) de grands équipements dont Génissiat fut le symbole, mais son cours, dans les régions de plaine ou de montagne, n’a pas été fortement perturbé. Le bas Rhône, à travers la Camargue et divers canaux, dont le Canal du Midi est le plus connu, a été l’objet d’un travail considérable qui a fait largement connaître le nom de Philippe Lamour, le PDG de la Compagnie du Bas-Rhône-Languedoc. Entre ces deux tronçons, de Lyon jusqu’en Arles, le Rhône dit “moyen” s’est identifié à un couloir, un corridor qui servait de séparation commode jadis entre le Royaume et l’Empire, plus récemment entre des départements qui portent le nom d’affluents importants, la Drôme et l’Ardèche.
Le couloir rhodanien est devenu un axe de circulation essentiel, tandis que le fleuve contribuait à fournir l’énergie électrique au pays tout entier, sous forme hydraulique d’abord, sous forme nucléaire ensuite. La vallée du Rhône prenait ainsi une importance considérable pour tous ceux qui avaient besoin d’énergie ou de transport, bien au-delà de la Région Rhône-Alpes, de l’Europe du Nord jusqu’à celle du Sud. Qu’en était-il pour ses habitants ? Ils pouvaient se réfugier dans le souvenir : celui de Mistral ou des bateliers ; ils pouvaient tenter de se protéger des crues, d’en bénéficier parfois (par les alluvions déposés), plus souvent d’en subir les effets dévastateurs (comme encore récemment en 1993-1994). Ils constataient leur dépendance, loin des centres de décision, et ne pouvaient guère peser sur un développement qui se servait d’eux plus qu’il ne les servait. Comme les lignes TGV, comme 1’autoroute, le canal Rhin-Rhône ne les concernait guère, porté qu’il était par les intérêts du Nord-Est ou de l’extrême Sud de la France.
Robert CHAPUIS
Dans peu de temps, les amoureux de la nature et du
vélo pourront partir du Léman et voir quelques jours
plus tard le soleil se lever sur la mer aux confins de la Camargue
ou des étangs héraultais. Pour autant, l’itinéraire
complet ne serait rien sans la magie du parcours. En vélo
comme au cinéma… pour découvrir les multiples
richesses patrimoniales qui bordent les voies d’eau. C’est
cette alchimie qui est recherchée.
Fin 1997, l’Établissement Public Territorial
de Bassin Territoire Rhône signait avec la Compagnie Nationale
du Rhône et Voies Navigables de France une convention les
liant pour la réalisation d’un parcours de randonnée
cyclable le long du Rhône, entre la Suisse et la Méditerranée.
L’EPTB Territoire Rhône, maître d’ouvrage
des études a, pendant trois ans, fait appel à divers
spécialistes, aux techniciens des Conseils généraux,
des Comités départementaux du Tourisme pour que
la véloroute du Léman à la mer deviennent
plus qu’un projet.
Stéphane MANSON et alii
La disposition dominante des vallées ardéchoises profondément incisées dans le talus oriental du Massif-Central a séculairement privilégié, dans l’ancien Vivarais comme dans le département de l’Ardèche, les relations transversales Ouest-Est ou Nord-Ouest-Sud-Est ; d’autant plus qu’elles s’inscrivaient sur de plus vastes courants d’échange entre le cœur du Massif-Central, voire des contrées plus lointaines d’Europe du Nord-Ouest d’une part, la vallée du Rhône, voire les pays méditerranéens d’autre part. Faut-il rappeler le trafic séculaire des muletiers, les migrations alternantes des transhumants et des saisonniers, le système de relations marchandes lié à l’élevage du ver à soie tout comme à celui du moulinage ?
Henri GUIBOURDENCHE
Je suis un enfant du Rhône. Né à Bourg-Saint-Andéol, mes grands-parents me racontaient la batellerie à vapeur, la navigation dangereuse, tant en période de crue qu’à l’étiage, et ces temps anciens qui ont fait du “Bourg” une puissance économique locale. Le patrimoine bourguésan, riche et diversifié, nous rappelle encore la présence d’une bourgeoisie bien installée qui a su tirer sa fortune du fleuve.
Au carrefour de quatre départements, la région n’a pas tardé à voir son développement économique s’accélérer, souvent sans grande cohérence, et globalement au profit de la rive gauche, moins contrainte par son relief, et peut-être aussi moins attachée à son agriculture. La seconde moitié du XXe siècle a donc été marquée par la mobilité avec des jeunes de plus en plus enclins à franchir le Rhône pour aller travailler de l’autre côté et s’y installer parfois. L’attractivité atteindra son paroxysme avec le développement de la C.N.R., du nucléaire et de ses activités rattachées.
Pascal TERRASSE