
Ce cahier est disponible. Si vous souhaitez le commander, reportez-vous en bas de page.
Vous pouvez accéder à un résumé de chaque article en cliquant sur son titre.
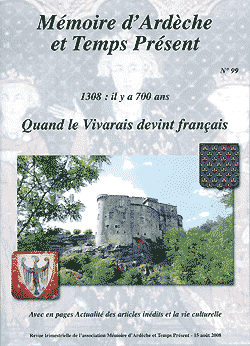
Château de Largentière |
Les territoires se font, se défont, se transforment au fil
de l'Histoire, avec des durées de vie variables, au rythme de l'évolution
des sociétés et des intérêts en présence.
L'histoire actuelle en montre parfois cruellement de nombreux exemples.
Un schéma classique présente le département
de l'Ardèche comme héritier du Vivarais, lui-même successeur
de la lointaine Helvie, une entité presque immuable depuis 2 000 ans...
La réalité est beaucoup moins simple.
Au début de cette année, nous avons passé sans nous en apercevoir le 700e anniversaire du traité de 1308 qui consacrait l'ultime étape du rattachement du Vivarais, auparavant terre d'empire, à ce qui était à l'époque le royaume de France.Voilà en tout cas une occasion toute trouvée pour l'équipe de Mémoire d'Ardèche et Temps Présent de se plonger en pleine période médiévale, de redécouvrir les travaux considérables de Jean Régné, de Pierre Babey, que les auteurs de ce Cahier ont largement sollicités, mais de porter aussi un regard neuf sur l'événement et sa portée.
Dans une première partie consacrée à l'événement
et à sa genèse du XIIIe siècle à 1308,
Christian Frachette fait l'état des lieux, analyse les forces en
présence ainsi que la patiente pénétration capétienne
dans un espace éclaté. Juliette Thiébaud pour la partie
nord autour de Tournon, et Jacques Schnetzler pour les confins sud-ouest
de notre département actuel en explorent les formes et les stratégies
locales. Vient ensuite la présentation du document
accompagnée de son analyse et d'un article de Colette Véron
sur l'hommage. On notera que les relations entre l'évêque de
Viviers et le capétien échappent à cette pratique très
répandue à l'époque. Et ceci non seulement parce que
l'un des partenaires est un homme d'Eglise, mais surtout parce que les terres
concernées constituent un alleu par rapport au roi de France. Ce
n'est donc pas en s'appuyant sur la pyramide féodale que celui-ci étend
son pouvoir sur le Vivarais épiscopal. C'est en y affirmant de façon
plus moderne le principe de sa souveraineté.
Nous aurions voulu publier dans ce numéro des photographies
du document original conservé aux Archives nationales, mais l'opération
de déroulement du parchemin demande un délai qui nous oblige à renvoyer
cette publication à plus tard. C'est la traduction fournie par Pierre
Babey dans sa thèse qui a servi de base à l'analyse centrale. L'exercice
de la justice, principal vecteur du pouvoir dans cette époque encore largement
féodale, mobilise une bonne partie des clauses du traité.
La seconde partie porte essentiellement sur les deux
siècles (XIVe et XVe siècles) postérieurs à l'événement,
afin de repérer comment, dans un contexte de crises et de profonds
bouleversements (Guerre de Cent ans, épidémies de peste, mutations économiques,
sociales, culturelles...), s'est imposé le pouvoir royal, selon un
jeu plus ou moins subtil avec l'évêque et son chapitre. Christian
Frachette analyse ici dans une démarche éclairante, la mise
en place, pour des considérations fiscales, des Etats du Vivarais.
L'unité du Vivarais, son extension au nord de l'Eyrieux et du Doux
est alors en construction. La fiscalité médiévale largement
explorée ici par Robert Valladier-Chante, donne aussi l'occasion à Colette
Véron de mener une enquête sociale nourrie des dernières
approches en la matière, confrontant statut, anthroponymie et toponymie.
Le travail de Michel Cros sur les patronymes occitans francisés
du compoix de Bourg-Saint-Andéol du début du XVIe siècle
aborde la question des mutations culturelles, tandis qu'Alain Fambon rappelle
la mémoire encore vivante des transactions de 1307-1308, quatre cents
ans plus tard, lors de la mise en place des offices de maire sous Louis XIV.
Une mémoire quelque peu oubliée depuis et que ce Cahier aura voulu rafraîchir.
Jean-Louis ISSARTEL